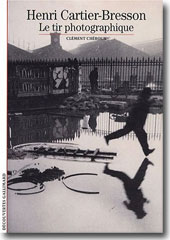Les poètes syriens sont bien vivants. Sauf les morts bien entendu. Ou les poètes en prison.
Les poètes vivants – lorsqu’ils se rencontrent – parlent de haricots blancs. Ils rient aux blagues de l’un d’entre eux. Ils parlent d’araignées, de points cardinaux, de sosies, de pays sans patrie qu’est la Syrie aujourd’hui, de faim, de feux de mots.
Les poètes syriens lorsqu’ils se rencontrent parlent de poésie et de poètes emprisonnés. Ils sont nombreux les poètes syriens, en exil ou en prison. Les poètes prisonniers envoient des poèmes à leurs amis poètes en exil et ces poèmes sont lus en public, en arabe et en français grâce à la traduction de Dima Abdallah, comme ce samedi 3 mai, à Paris, à l’Institut des Cultures d’Islam, un centre culturel de la mairie de Paris situé dans le quartier de la Goutte d’Or. Une soirée dédiée aux poètes Nadhem Hammadi, Ajwad Amer, Wael Saad Eddine, Nasser Boundouq.

« On va lire leur poésie jusqu’à leur libération, a annoncé Hala Mohammad, à qui l’Institut avait donné carte blanche, samedi 3 mai. On espère la liberté pour tous les poètes et pour tous les Syriens. »
La poétesse syrienne aura encore carte blanche samedi 10 mai et samedi 14 juin. Jamel Oubechou, président de l’Institut, ancien conseiller culturel près l’Ambassade de France en Syrie (2002-2006), l’a souligné en présentant la soirée, justement intitulée « Réfugiés en poésie » : « Pour que les Syriens soit reconnus pleinement humains, nous devons leur donner la parole. »
Moins célèbres qu’Adonis, les poètes présents à La Goutte d’Or ce soir-là ont fait salle comble. Le plafond semblait bas tant leur parole est belle et forte, elle remplit l’espace. Lectures en français par Hala Omran et Wissam Arbache.
Extrait du Sosie, d’Aref Hamza, qui vit en Turquie : « À présent ils tuent mon quarantième sosie et je vivrai seul. Extrait de Victimes : « Les mots ne sont pas les seuls victimes des explosions. » Du Roi des points cardinaux : « Tes quatre fils que tu as nommés les Rois des points cardinaux, nous venons de les enterrer. » Ou encore : « Depuis deux jours tu vis avec ta rage de dents, tu n’es alors plus seul. » Ou : « Lorsque tu dors auprès de moi, cela vaut un état tout entier. »
« J’ai abreuvé cette vie même si elle s’est perdue.»
Entre les différentes lectures des poètes présents, Hala Mohammad a lu des poèmes envoyés depuis une prison de Syrie. Tels Nazim Hamadi, poète arrêté le 10 décembre 2013, Nasser Bunduq, arrêté à Damas le 17 février 2014, ou cet autre poète : « J’ai rêvé de tes yeux dans la chambre de la mort. J’ai rangé mon rêve. J’ai rêvé de tes yeux. Je les ai écrits. Et j’ai sombré. »
La poétesse Khouloud Sageiar a lu ses poèmes :
« La mer est immobile. Je suis ce qui reste des écumes du départ. »
Ou encore : « Les poèmes que tu ne dis pas s’effondrent. Seules tes blessures ne pourrissent pas. »
« Il pleut des faire-part de décès. le terre est en feu. »
« Si tu parviens à leur échapper, tu ne pourras échapper à toi-même. Ils t’ont métamorphosé en araignée. »
Lukman Derky a réussi à faire rire l’assistance ou à l’émouvoir :
« Ô Syrie comme tu me ressembles. La différence c’est que j’ai appris à mes enfants les cris et les haricots et que tu leur a appris le silence et la faim. »
Et son poème intitulé Noirceur :
« Nous sommes ceux qui furent tués dans toutes les guerres. Les guerres nous ont épuisés.»
À un fonctionnaire d’une ambassade occidentale qui lui refuse un visa :
« Je ne te veux pas ô liberté. Je ne suis qu’un visiteur. Je visite ta liberté. La liberté est à ceux qui la font et non au visiteur. »
Dara Al Abdallah, était en 5e année d’études de médecine quand il choisit l’exil pour l’Allemagne : « Pourquoi faut-il que les outils de mort soient beaux ? »
Yasser Khangar, réside dans le Golan. Il est interdit par Israël de quitter le pays : « Une enfant s’est échappée des gouffres de la mort. » Voir une de ses lectures en arabe sur You Tube
Monzer Masri, interdit de sortie de Syrie : « Comment quand on part sans revenir ? On revient ? »
Écouter un de ses poèmes lu en arabe sur lyrikline. Lire la poésie de Monzer Masri sur le blog d’Annie Bannie.
Dans Médiapart lire un poème de Nazîh Abou Afach, Ô temps étroit, ô vaste terre.
Lire un poème de Hala Mohammad et sa biographie dans L’Orient littéraire.
Lire son interview sur le site d’Arte à l’occasion du festival de littérature de Berlin en 2013.
Déjà en juillet 2011, Nouri Al Jarrah, poète syrien résidant à Londres nous avait ému lors de sa lecture de ses propres poèmes, en arabe, puis en traduction française, du haut du Mont Saint-Clair, à Sète lors du festival Voix vives de Méditerranée en Méditerranée.