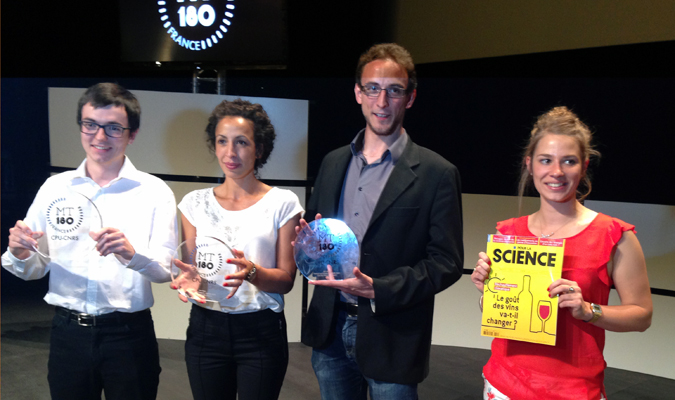Sortant de l’examen de thème arabe, pour la seconde fois cette année, il était absolument persuadé que jamais il ne se découragerait.
Malgré les inconnues qui le travaillaient et lui infligeaient tous les tourments possibles durant les épreuves qu’il s’était choisies, lui faisant goûter toute une gamme de sentiments, de la forfanterie de potache à la honte compacte de ses limites, du plaisir débridé au doute existentiel, il avait une certitude : il n’était pas de ceux qui renonceraient, et cela, quels que soient les résultats.
Point d’orgueil ni de courage dans cette volonté, simplement la voix étroite d’un passage, d’une sente, d’un détour entr’ouvert par ces mots du poète Mahmoud Darwich : « La terre nous est étroite. Elle nous accule dans le dernier défilé et nous nous dévêtons de nos membres pour passer. »
Il ne mesurait pas l’arc tendu de sa vie à un bilan notable, même à une satisfaction éphémère, mais à l’aune de la route inventée. Nul besoin de convoquer Goethe (« Le but c’est le chemin. ») ou Foucault (« Faire de sa vie une œuvre d’art. »). L’épreuve lui faisait pressentir que, plus le terme semblait improbable et la sanction finale incertaine, plus les irréfragables moments vécus l’enchantaient et lui laissaient une marque durable.
« Une route de traverse »
Il en était transporté, traversé. « Traverse », un de ces mots communs qui disent des choses admirables pour peu qu’on les considère sous leurs aspects divers. « Traverse » désigne à la fois un raccourci dans l’exemple « une route de traverse », un passage, mais aussi – voir le chemin de fer – ces pièces de bois ou de métal qui maintiennent l’écartement entre deux rails. C’est aussi un synonyme d’embûche, de revers.
« Traverse » illustre magnifiquement ce qui fait la beauté et l’apprentissage d’une langue. À la fois un raccourci vers l’autre et un chemin érigé d’obstacles. La langue nous traverse car elle exprime une vision du monde. Elle est une traverse qui nous mène à l’autre. Elle est faite de traverses qui maintiennent cet écart. Elle nous permet de traverser, c’est-à-dire de passer d’un côté à l’autre. Enfin, elle nous résiste.
Empruntant la drive de la langue, qui n’est pas dérobade mais plutôt dérive et bifurcation, il songeait à cette quête d’une langue toujours nouvelle, toujours présente, qui n’englobait pas une totalité mais qui traversait tout et était traversée par tout, des questions aux émotions, de la connaissance à l’amour, un sésame pour approcher un monde d’effroi et de beauté. Sur ce chemin, des jalons encore inconnus il y a un an portaient des noms devenus des présences indélébiles : Abdallah, Kadhim, Majdouline, Mohamed, Roula, Samar, Wendy… sans oublier des groupes à la dynamique motivante, tel mardi à République, tel autre jour aux Grands-Moulins.
Quelles que soient les affres endurées et les issues entrevues, seul comptait cet émerveillement, hors de toute mesure.
π
« Ce que la vie peut être belle, quand elle ne connaît pas de plus grande épreuve qu’un examen ! Par la suite, les choses se compliquent. » Inaam Kachachi, Si je t’oublie, Bagdad, p. 188 (Liana Levi)