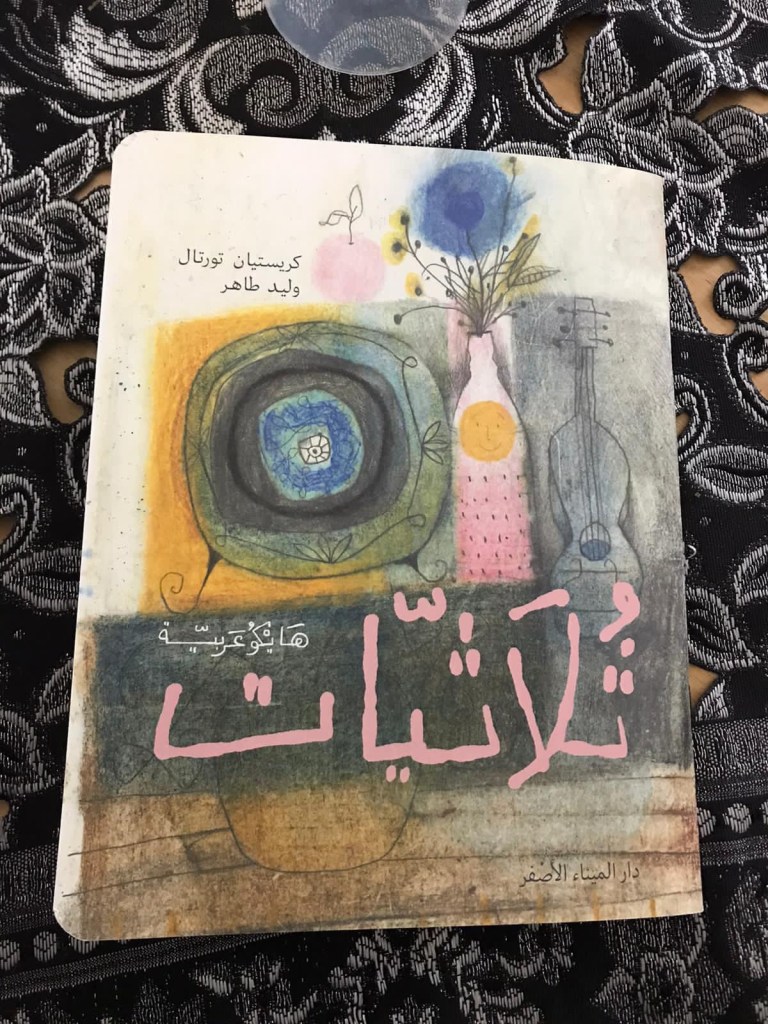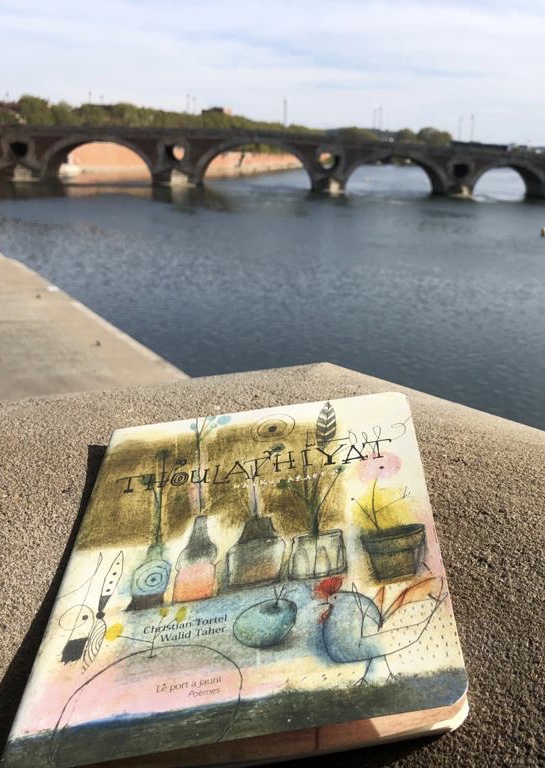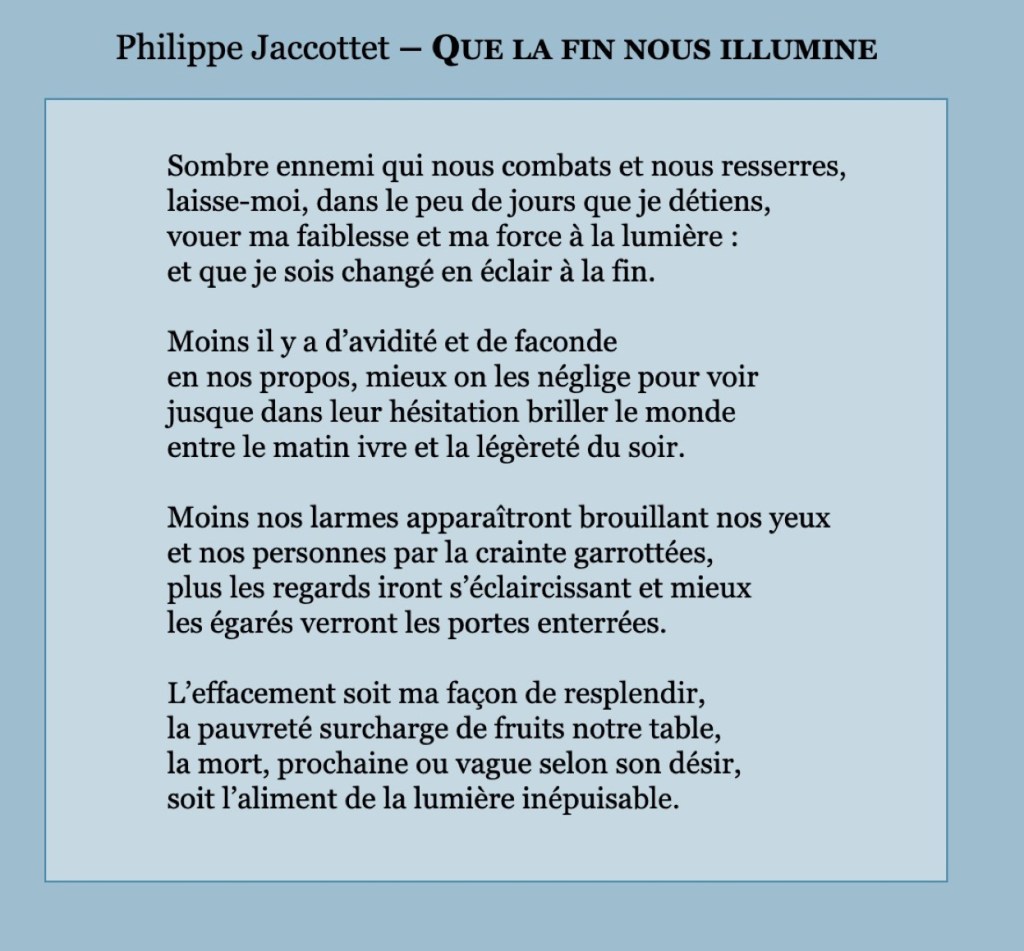Film plein de douce mélancolie, Sous le ciel d’Alice, le premier long-métrage de Chloé Mazlo étonne comme un livre de contes dans un pays en guerre, le Liban des années 1970.
Le film raconte l’histoire des grands-parents de la réalisatrice, une grand-mère venue de Suisse dans les années 50 pour s’occuper des enfants d’une famille bourgeoise de Beyrouth (interprété par Alba Rohrwacher). Elle s’éprend d’un homme (Wajdi Mouawad) qui rêve non de conquête spatiale mais qu’enfin un Libanais s’envole dans l’espace, tout simplement.
[Sur ces rêves d’espace et leur réalité, revoir le beau film documentaire The Lebanese Rocket Society, de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (2013).]
La rencontre entre cette femme grande et blonde à l’accent d’ailleurs et cet ingénieur rêveur donne le ton au film. Si vous ajoutez des séquences filmées en stop motion, cette technique d’animation en 3D, vous avez un joli cocktail qui confère à l’ensemble une forme d’onirisme doux amer. Une technique qui contribue à accélérer le temps laissant toute sa place aux scènes de famille filmées théâtralement.
Dans une espèce de « capharnaüm surréaliste » comme l’écrit le dossier de presse, dans cet « îlot fictionnel » qu’est un appartement, la guerre n’apparaît que rarement et toujours sous de manière surprenante : le cœur de l’héroïne fond, les amoureux chassent les cigognes, l’écran est partagé en split screen lors d’un échange téléphonique entre les parents suisses et le Liban, des personnages à l’abri dans un sous-sol dessinent, une allégorie de la mort danse face à une femme-cèdre (radieuse Nadine Naous) devant un mur aux couleurs du Liban, après une crise du couple, l’appartement est séparé par des plantes en symbole de la ligne verte, la ligne de démarcation entre ennemis, belle idée pour réunir histoire d’une famille et histoire d’un pays.
Souvent les couleurs de la pellicule – Chloé Mazlo et sa chef-opératrice Hélène Louvart ont fait ce choix judicieux – renforcent ce voyage dans le temps : « Le grain du super 16 permet de laisser au spectateur deviner les choses : les traits des visages ne sont pas trop lisses, ils sont au contraire fous, vaporeux. Le super 16 fait disparaître cette impression de raideur pour laisser place à ce que les Italiens appellent le « sfumato » en histoire de l’art : un contour enveloppé, des couleurs adoucies. »
Alice va ainsi traverser quinze ans de guerre entre romantisme, incrédulité et impuissance. Elle reste dans son pays d’adoption alors que partout autour d’elle on fuit.
Sous le ciel d’Alice, premier long métrage de Chloé Mazlo est comme un album de famille dans un ciel qu’on rêve étoilé alors que résonnent le bruit des bombes. C’est l’inverse exact de la Palestine du poète Mahmoud Darwich qui dans l’une de ses autobiographies – La Palestine comme métaphore (1997) – partait en quête d’un pays perdu à travers la langue et l’histoire. Avec Chloé Mazlo, le lieu est si fort qu’il absorbe tout, comme une faille spatio-temporelle où tout vient se rattacher, comme si la mémoire était ce grand aimant qui pouvait empêcher l’éclatement du puzzle de l’enfance.