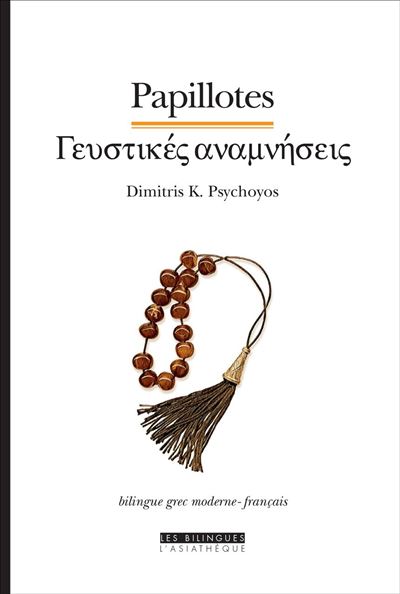Je comprends de moins en moins de choses. Et à mesure que les années passent j’en comprends de moins en moins. Cela est vrai. Mais le contraire est également vrai, à mesure que les années passent je comprends de plus en plus de choses. Oui, il est également vrai qu’à mesure que les années passent je comprends beaucoup de choses, tant de choses que j’en suis presque effrayé. Le fait est que je suis découragé devant le peu de choses que je comprends et presque effrayé devant la masse de choses que je comprends. Comment se fait-il que les deux puissent être vrais, que je puisse à la fois comprendre de moins en moins et de plus en plus?
La pensée réfléchie nous dira sans doute alors que comprendre peu de choses c’est aussi en comprendre beaucoup, et je crois qu’en un sens, peut-être au sens gnostique du terme, cela est vrai, à moins que cette même pensée réfléchie nous dise qu’il y a deux sortes de compréhension. Et peut-être est-ce ainsi, peut-être peut-on dire tout simplement qu’à travers cette forme de compréhension qui a recours aux concepts et à la théorie je comprends de moins en moins, et que la portée de cette forme de compréhension qui a recours à la fiction et à la poésie je comprends de plus en plus. Peut-être est-ce ainsi. En tout cas, c’est ainsi que je le ressens puisque, après avoir écrit un certain nombre d’essais théoriques, j’ai progressivement abandonné cette forme d’écriture au profit désormais presque exclusif d’un langage qui n’est pas en premier lieu concerné par la signification, mais qui avant tout est, qui est lui-même, un peu comme les pierres et les arbres et les dieux et les hommes, et qui ne signifie qu’en second lieu. Et à travers ce langage qui d’abord est, et qui ensuite seulement signifie, il me semble comprendre de plus en plus, alors qu’à travers le langage ordinaire, celui qui d’abord signifie, je comprends de moins en moins.
Cela tient d’abord à moi et à ma propre histoire. Et, pour que les choses soient dites, j’ai commencé à écrire des petits poèmes et des histoires à un âge si précoce que c’en est gênant, oui, gênant parce que l’image du jeune garçon qui, à l’âge de douze ans, se retire dans sa chambre où on le laisse tranquille, pour écrire des petits poèmes et des histoires, ne correspond que trop bien au mythe auquel l’artiste est censé se conformer, et qui dit que si on n’est pas né artiste, du moins l’est-on devenu à l’âge le plus tendre. En ce qui me concerne, cela correspond bien. Et je suis toujours sceptique vis-à-vis de tout ce qui correspond trop bien. Pourtant, c’est ainsi. Depuis ma prime jeunesse j’ai toujours écrit, et l’écriture a en quelque sorte toujours été sa propre fin, ce n’était pas une activité à laquelle je me livrais pour dire quelque chose, pour émettre une opinion, mais presque comme une manière d’être au monde, comme si on était au monde, comme si on y était de manière satisfaisante, à travers ce que l’on écrivait, et qui à son tour était là, de manière si évidente dans sa présence.
Car lorsque j’écris un texte qui me paraît bien écrit, quelque chose de nouveau vient au monde, quelque chose qui n’était pas là auparavant, j’ai en quelque sorte créé une présence, et cela, le plaisir de faire surgir par l’écriture des personnages et des histoires, voire des univers, que personne ne connaissait auparavant, pas même moi, cela m’étonne et me réjouit. Personne ne connaissait cela avant que je ne l’écrive. Et d’où cela vient-il? Je ne sais pas, car pour moi aussi cela est nouveau. Jamais je n’y avais pensé auparavant. L’écriture, la bonne écriture, devient ainsi le lieu où quelque chose d’inconnu, quelque chose qui auparavant n’existait pas, se met à exister. C’est cela, l’écriture comme un état où quelque chose que l’on pourrait presque désigner comme un univers, apparaît et se met à exister pour la première fois, c’est sans doute cela qui, dans l’écriture, me procure le plaisir le plus fort. Un univers entier se crée chaque fois que l’on écrit quelque chose de bien. Car tout bon texte, même un poème, est en quelque sorte un univers entier, qui n’existait pas auparavant, et qui apparaît à travers la bonne écriture.
Je pense souvent à l’écriture comme à une déviance, comme si l’écriture était la manifestation même de cette déviance, un peu à la manière d’une dépendance, car de même qu’on peut être dépendant de tout, que ce soit d’une collection de timbres ou du jeu ou de l’héroïne, de même peut-on être dépendant de l’écriture. En un sens c’est aussi simple que cela. J’apprécie certes la reconnaissance que l’on me témoigne, je l’apprécie peut-être plus que je ne veux l’admettre, mais en même temps cela me gêne, car lorsqu’on arrive même à gagner correctement sa vie avec cette déviance, avec cette écriture, on peut se demander si ce n’est pas pour cela que l’on écrit, pour gagner de l’argent, ou pour connaître la gloire et la renommée, comme on dit. Et pourtant, non. Je n’ai aucune satisfaction, je n’ai pas envie, tout simplement, d’être mieux que les autres, j’éprouverais même un certain plaisir criminel à être pire qu’eux. Mais j’aimerais avant tout être là où sont les autres, aussi peu visible que possible. Je voudrais être comme les autres, et je voudrais qu’ils me laissent en paix avec moi-même, avec les miens, et avec mon écriture.
Et puis il s’avère qu’être écrivain, ce n’est pas cela. En Norvège, tout au moins, si vous écrivez, si vous êtes un homme d’écriture, c’est ou bien que vous êtes pire que les autres, puisque vous écrivez en quelque sorte parce que vous ne trouvez pas votre place dans la vie, et que l’écriture signifie que vous êtes proche de la maladie mentale, si vous n’en avez pas déjà franchi la limite, ou bien que vous êtes mieux que les autres, que vous avez un talent particulier, quelque chose qui fait de vous un être que l’on admire, et qui fait de ce que vous écrivez un objet digne d’être enseigné dans les écoles, qui vous apporte des prix prestigieux et vous transforme de votre vivant en une sorte de phénomène classé que les gens se vantent d’avoir rencontré lorsqu’ils se retrouvent dans les cafés à la mode.
Le découragement me gagne. Et de nouveau, comme lorsqu’on avait douze ans, on se réfugie dans l’écriture. Ce lieu que l’on s’est créé dans la vie, ce lieu où, renonçant aux concepts et aux théories comme au consensus social et à ses hiérarchies de valeurs, on cherche à s’approcher d’un endroit où on ne comprend pas, d’une absence presque totale de compréhension, et à partir d’où, par le mouvement et le rythme ou je ne sais quoi, on essaie de faire surgir quelque chose qui est seulement et qui de ce fait est aussi une sorte de compréhension, pas une compréhension qui correspondrait à tel concept ou à tel autre, à telle théorie ou à telle autre, mais une compréhension qui fait que le langage signifie tour à tour une chose et son contraire, et autre chose encore. Le lieu d’où vient l’écriture est un lien qui sait bien plus de choses que moi, car en tant que personne je sais bien peu de choses, et peut-être Harold Bloom a-t-il raison lorsqu’il dit que le lieu de l’écriture, ce que sait le lieu de l’écriture, ressemble à ce que savaient les anciens gnostiques, à ce qui était à l’origine de leur gnose. Une connaissance qui est de l’ordre de l’indicible. Mais qu’il est peut-être possible d’exprimer par écrit. Une connaissance qui n’est pas quelque chose que l’on sait, ou que l’on possède, au sens habituel du terme, car ces connaissances-là ont toujours un objet, mais au contraire une connaissance sans objet, qui est seulement. Ainsi, ce qu’on ne peut pas dire, il faut l’écrire, comme a dit un philosophe français pas vraiment inconnu (Derrida), paraphrasant l’énoncé d’un philosophe autrichien, Wittgenstein.
Et bien sûr, parler de la gnose de l’écriture n’est qu’une tentative de dire quelque chose à propos de ce que sait l’écriture. Pourtant, sans me considérer comme un gnostique (ni comme quoi que ce soit d’autre), il me paraît juste de le dire de cette manière. Et le fait qu’écrire, écrire bien, s’apparente, comme on l’a dit, à une prière, me semble tout à fait évident. Mais cela paraît alors comme une sorte de prière presque criminelle.
Avril 2000
Jon Fosse
Rêve d’automne / Violet / Vivre dans le secret
Traduit du Norvégien
par Terje Sinding
L’Arche Éditeur
pages 181-185
posté sur Facebook par Dieudonné Niangouna, le 12 février 2025.