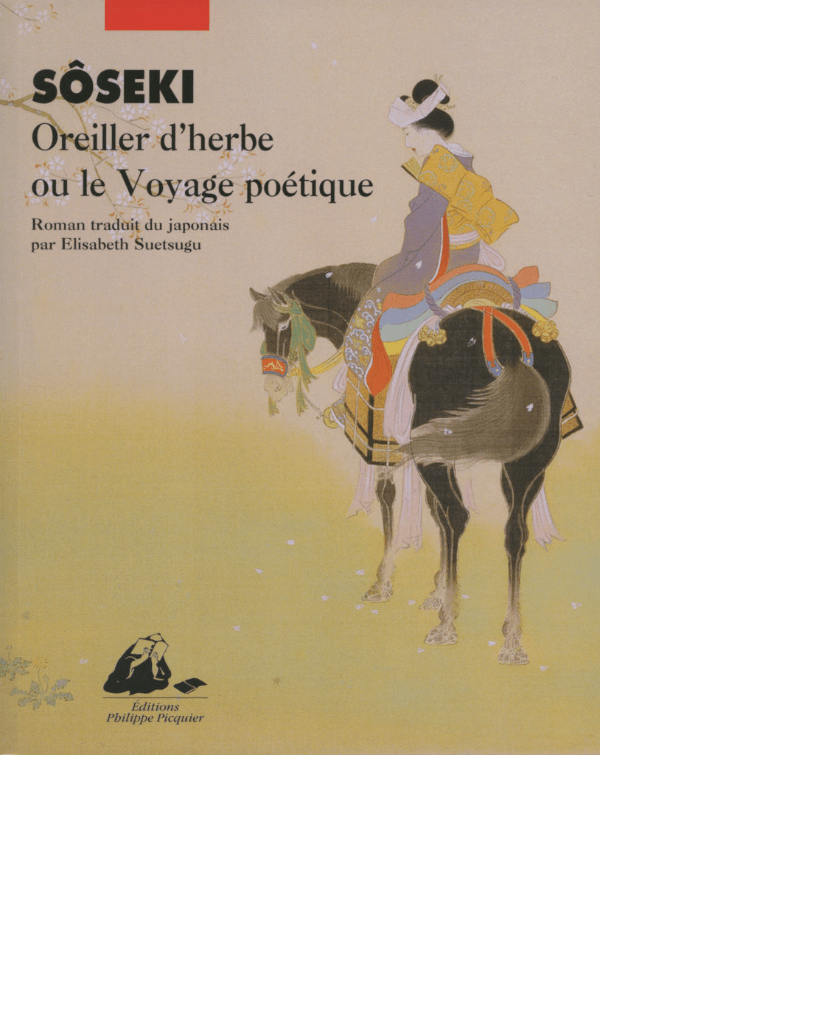De Barthes (1966) à Marx (2020)
En 1966, Roland Barthes publiait Critique et vérité, livre de 86 pages publié l’année phare du mouvement structuraliste.
« Critique » car il développe une vision de la critique en opposition à une critique présentée comme traditionnelle. « Vérité » (sans initiale majuscule au mot) car Barthes examine ce qu’est la vérité en littérature à l’encontre de la vérité prétendument univoque de la critique érudite.
Ce jeudi 23 janvier 2020, le philologue William Marx prononce sa Leçon inaugurale au Collège de France, chaire des Littératures comparées « dans une bibliothèque mondiale ».
Dans Critique et vérité, sixième essai de l’auteur (le premier étant Le Degré zéro de l’écriture, publié en 1953), Barthes opère un décentrement puis un renversement.
Un décentrement : il valorise la relation œuvre-lecteur au détriment de la relation auteur-œuvre. Un renversement : il considère l’œuvre et l’auteur non pas comme des « évidences » (seules prises en compte par le « Vraisemblable critique » de la critique traditionnelle) mais comme des éléments – des signes – d’un ensemble de symboles, leur vérité n’étant pas intrinsèque, à rechercher à l’intérieur de l’œuvre et selon les volontés de l’écrivain mais dans un ensemble où est incluse l’œuvre. A ce propos, il va jusqu’à écrire (p. 62) : « Ces œuvres [de la littérature] sont elles-mêmes semblables à d’immenses « phrases », dérivées de la langue générale des symboles (…) à travers une certaine logique signifiante qu’il s’agit de décrire ».
La force du propos de Roland Barthes, que certains ont assimilé à un « manifeste », a semble-t-il bénéficié d’un contexte et d’une controverse, deux facteurs socio-intellectuels majeurs, qui, de fait, 54 ans après, sont aussi importants à considérer que le contenu lui-même.
Le contexte de l’époque : 1966, « année-lumière », « année mirabilis »
Dans l’histoire des idées, la décennie structuraliste est à son apogée en 1966, qualifiée d’« année-lumière » par l’historien des idées François Dosse, auteur de Histoire du structuralisme, 1991.
Cette seule année 1966 – « année mirabilis » [merveilleuse] – a d’ailleurs fait l’objet d’une série de vingt-deux conférences, pas moins, au Collège de France, organisées en 2011 par Antoine Compagnon.
Entre 1963 et 1966 sont publiés Sur racine, de Roland Barthes (1963), qui suscitera la controverse Barthes-Picard (1965-1966) ; Théorie de la littérature, de Tzvetan Todorov (1965) ; Les mots et les choses, par Michel Foucault (1966) ; Critique et vérité, de Roland Barthes (1966) ; Sémantique structurale, d’Algirdas Julien Greimas (1966) ; les Écrits de Jacques Lacan (1966) ; Lire le Capital, ouvrage collectif sous la direction de Louis Althusser (1965).
Une décennie où les intellectuels se posent des questions en remettant en cause le socle même de littérature, de sa définition comme de son rôle, de son analyse et donc de sa critique.
Pour illustrer l’importance de ce moment clé dans l’histoire des idées, pour le cas français, Antoine Compagnon dans une leçon récente au Collège de France citait le « fameux article de Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », texte d’une conférence donnée en février 1969 à la Société française de Philosophie. Elle venait peu après un article non moins fameux de Roland Barthes, au titre plus fracassant, « La mort de l’auteur », publié en 1968. Ces deux textes, qui ont figuré parmi les pages les plus photocopiées par les étudiants de lettres avant de devenir disponibles, bien plus tard seulement, dans des recueils posthumes (Barthes, Le Bruissement de la langue, 1984 ; Foucault, Dits et écrits, 1994), énonçaient le credo de la théorie littéraire des années 1970, diffusée sous le nom de post-structuralisme, ou encore de déconstruction. »
Les questions des intellectuels des années 60 portent non seulement sur le statut d’auteur mais aussi sur le statut de l’œuvre avec, par exemple L’Œuvre ouverte d’Umberto Eco publié en 1962, qui se pose la question de ce qu’est une œuvre d’art.
La controverse Picard/Barthes
C’est dans ce bouillonnement intellectuel que s’inscrit la publication en 1966 de Critique et vérité, troisième temps de la controverse Picard/Barthes.
Premier moment, en 1963, quand Barthes publie Sur Racine, homme de théâtre du XVIIe siècle, modèle de la tragédie classique, académicien français, dont l’un des spécialistes reconnus par l’Université est Raymond Picard.
Celui-ci lui répond en 1965 par une critique assassine intitulée Nouvelle Critique ou nouvelle imposture (éditions Jean-Jacques Pauvert), titre dont la formulation est sans ambiguïté.
Et Barthes répond à son tour par Critique et vérité.
Ces trois moments constituent « l’une des plus retentissantes controverses ayant embrasé les sciences sociales et l’interprétation des textes », selon l’historien Christophe Prochasson, aujourd’hui président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales.
Raymond Picard (1917-1975) était un universitaire de référence sur l’œuvre de Jean Racine avait dirigé l’édition des œuvres compètes du dramaturge dans la collection La Pléiade de Gallimard.
La « controverse » est définie par le Trésor de la langue française (TLF) comme étant une « Discussion argumentée, contestation sur une opinion, un problème, un phénomène ou un fait; par métonymie ensemble des éléments divergents ou contradictoires du débat. »
En l’occurrence, il serait plus juste de parler de « polémique », mot dont l’étymologie, précise le TLF , provient du grec π ο λ ε μ ι κ ο ́ ς [polemikos, radical pólemos] « qui concerne la guerre », « disposé à la guerre », « batailleur, querelleur », tant il s’agit d’une « guérilla intellectuelle » aux enjeux qui dépassent le cadre des idées pour aller sur le terrain du statut universitaire, médiatique et d’une position, voire une posture, dans le monde intellectuel des années 60.
La sociologie traite abondamment des controverses scientifiques (voir notamment le hors-série de La Recherche N°24 daté décembre 2017-janvier 2018 ) mais s’intéresse peu aux controverses dans les sciences humaines. Pourtant, elles sont très révélatrices du mouvement des idées dans leurs multiples dimensions, scientifiques et sociales. Exception notable, Les grandes controverses philosophiques, hors-série de la revue Sciences humaines, Grands dossiers n°57, décembre 2019-janvier-février 2020 mais où la controverse Barthes/Picard est absente , sans doute qu’elle ne s’inscrit pas dans le champ strict de la philosophie mais la déborde largement.
Antoine Compagnon en fait un résumé contextualisé : « Critique et vérité, publié en février 1966 avec un bandeau « Faut-il brûler Roland Barthes ? », comporte deux parties : une réfutation violente et politique des arguments de Picard, puis un programme scientiste. Barthes se réclame de la Résistance, de l’avant-garde brimée depuis le xixe siècle ; il s’agit de pousser l’adversaire vers la droite, voire l’extrême droite, et de s’inscrire dans une lignée qui part de Proust, Freud, Lacan, Queneau, Chomsky, Mallarmé, Jakobson, Blanchot, et qui court jusqu’à Le Clézio, Bataille, Saussure, Lévi-Strauss, Lukacs, Goldmann ou Benveniste : il n’y a plus ni poète ni romancier, il n’y a qu’une écriture. Barthes propose de développer une science de la littérature ; la critique doit être un « discours qui assume ouvertement, à ses risques, l’intention de donner un sens particulier à l’œuvre », qui impose du sens au lieu d’analyser comment il se produit. »
Critique et vérité : un essai en deux parties
Première partie de Critique et vérité
Dans cette première partie (« Une réfutation violente et politique des arguments de Picard », selon les mots d’A. Compagnon), Barthes ne répond pas, ne se défend pas des critiques de Raymond Picard [qu’il nomme un seule fois dans le cours d’une phrase (p. 27) mais ne cite jamais, marque de « mépris », selon Danielle Deltel, cf. note 3]. Il contre-attaque sur un ton polémique, en prenant appui sur quelques notions qui caractérisent selon lui la critique académique, affirmant un contre-système, un autre point de vue sur la littérature, sur l’œuvre, sur la langue, convoquant à la rescousse linguistique et psychanalyse, toutes deux reliées dans le structuralisme.
[Ci-dessous les majuscules du texte d’origine sont respectées]
Dès l’introduction de Critique et vérité, Roland Barthes cherche à sortir du cadre du procès qui l’accuse d’ « imposture » (selon le titre de l’essai de R. Picard) :
« Ce que l’on reproche aujourd’hui à la nouvelle critique, ce n’est pas tant d’être « nouvelle », c’est d’être pleinement une « critique », c’est de redistribuer les rôles de l’auteur et du commentateur et d’attenter par là à l’ordre des langages. (p. 14)
Dans la première partie, Barthes s’attaque aux fondements supposés de la critique traditionnelle, fondements politiquement conservateurs, la nouvelle critique se présentant a contrario, comme avant-gardiste :
« Le Vraisemblable critique aime beaucoup les « évidences ». « Ces évidences sont surtout normatives. » (p. 17) : « il faut parler d’un livre avec « objectivité », « goût » et « clarté ». Ces règles ne sont pas de notre temps : les deux dernières viennent du siècle classique, la première du siècle positiviste. Il se constitue ainsi un corps de normes diffuses, mi-esthétiques, mi-raisonnables. (p. 37)
« Les règles du vraisemblable critique en 1965 » sont ses « censures » (p. 29).
Poussant plus loin cette logique de « sortir du cadre » [historique, idéologique], Barthes convoque les recherches de deux psychiatres spécialistes de l’aphasie pour étendre « l’asymbolie » à la littérature : « L’ancien critique est victime d’une disposition que les analystes du langage connaissent bien et qu’ils appellent l’asymbolie : il lui est impossible de percevoir ou de manier des symboles, c’est-à-dire des coexistences de sens. » (p. 43). Pire, il est victime d’une « surdité aux symboles (p. 45). L’ancien critique serait donc… handicapé.
Contre « l’empire absolu » de la lettre (p. 45), celui qui n’a pas encore écrit L’empire des signes (1970) affirme le droit à une « lecture symbolique » de l’œuvre (p. 44). Il plaide pour un « sens multiple » (p. 45) de l’œuvre. « L’œuvre a plusieurs sens », souligne-t-il encore (p. 54).
Deuxième partie de Critique et vérité
Dans cette seconde partie (« un programme scientiste », selon A. Compagnon), s’attachant à « la nature symbolique du langage (p. 53), « nous entrons dans une crise générale du Commentaire » (52), estime Barthes, réunissant plusieurs notions en une phrase : « Pendant longtemps, la société classico-bourgeoise [notion marxisante] a vu dans la parole un instrument ou une décoration ; nous y voyons maintenant un signe [notion linguistique] et une vérité [notion au carrefour de multiples écoles de pensée, mais Barthes ne détaille pas]. Tout ce qui est touché par le langage est donc d’une certaine façon remis en cause : la philosophie, les sciences humaines, la littérature. » (p. 53)
« La Langue plurielle ». Si « l’œuvre a plusieurs sens » (p. 54), la définition même de l’œuvre change : elle n’est plus un fait historique, elle devient un fait anthropologique, puisqu’aucune histoire ne l’épuise. La variété des sens (…) désigne, non un penchant de la société à l’erreur, mais une disposition de l’œuvre à l’ouverture [Barthes rejoint en cela Umberto Eco, dans L’Œuvre ouverte]; l’œuvre détient en même temps plusieurs sens, par structure, non pas infirmité de ceux qui la lisent. C’est en cela qu’elle est symbolique : le symbole, ce n’est pas l’image, c’est la pluralité même des sens. » (p. 54-55)
Et il a cette formule en raccourci : « L’œuvre propose, l’homme dispose. » (p. 56), tout en rappelant implicitement la filiation du structuralisme au Formalisme russe quand il cite « Roman Jakobson (qui) a insisté sur l’ambiguïté constitutive du message poétique (littéraire) (…) La langue symbolique à laquelle appartiennent les œuvres littéraires est par structure une langue plurielle. » (p. 58)
Barthes tente d’esquisser les contours d’une « science de la littérature (ou de l’écriture) ce discours général dont l’objet est, non pas tel sens, mais la pluralité même des sens de l’œuvre, et critique littéraire, cet autre discours qui assume ouvertement, à ses risques, l’intention de donner un sens particulier à l’œuvre. » (61)
L’essayiste déplace la question de l’auteur vers la question du mythe (« sans émetteur véritable ») : « L’auteur, l’œuvre, ne sont que le départ d’une analyse dont l’horizon est un langage : il ne peut y avoir une science de Dante, de Shakespeare ou de Racine, mais seulement une science du discours. » (66).
Deux ans avant son essai, radicalement intitulé « La mort de l’auteur » (publié plus tard, en 1984, dans Le Bruissement de la langue), Critique et vérité esquisse le principe d’une supériorité du texte sur l’auteur à l’opposé de la tradition classique : « En effaçant la signature de l’écrivain, la mort fonde la vérité de l’œuvre, qui est énigme. » (p. 65)
Barthes conclut par deux chapitres, l’un intitulé « La Critique » qui « affronte un objet qui n’est pas l’œuvre, mais son propre langage. » (p. 75) et qui « ne peut que continuer les métaphores de l’œuvre. » (p. 78), cette métaphore étant « infinie » (p. 79).
Le dernier chapitre a pour titre « La Lecture » car « seule la lecture aime l’œuvre, entretient avec elle un rapport de désir. Lire, c’est désirer l’œuvre. (…) Passer de la lecture à la critique, c’est changer de désir, c’est désirer non plus l’œuvre, mais son propre langage. » (85)
De Critique et vérité à la « Bibliothèque mondiale »
Lors de la sortie de Critique et vérité, la responsable du Monde des livres, Jacqueline Piatier, « pro-Picard », conclut ainsi son article : « Le lecteur, si cher à Roland Barthes, attend peut-être que le critique lui apporte autre chose que des périphrases poétiques qui obscurcissent plus qu’elles n’éclairent. Il attend que le critique jette un » pont » entre l’œuvre et lui, surtout quand il s’agit de littérature moderne, où un roman de Robbe-Grillet n’est pas à lire comme un roman de Balzac ni même comme un roman » objectal « . »
En revanche, la même année que Barthes, Tzvetan Todorov publie Les catégories du récit littéraire . Il est dans le même compagnonnage intellectuel que Barthes dont il précise la réflexion : « C’est une illusion de croire que l’œuvre a une existence indépendante. Elle apparaît dans un univers littéraire peuplé par les œuvres déjà existantes et c’est là qu’elle s’intègre. Chaque œuvre d’art entre dans des rapports complexes avec les œuvres du passé qui forment, suivant les époques, différentes hiérarchies. Le sens de Madame Bovary est de s’opposer à la littérature romantique. Quant à son interprétation, elle varie suivant les époques et les critiques. »
Si Todorov est plus précis que Barthes, c’est sans doute que l’objectif de Barthes est différent : lancer un pavé dans la mare, qu’on l’appelle manifeste ou acte de naissance de la Nouvelle critique. Quand l’époque est révolutionnaire, la polémique sert davantage le rebelle que l’universitaire installé.
« Barthes a riposté, mais a-t-il répondu ?, se demande Antoine Compagnon, qui a été élève de Barthes. Il est déjà ailleurs : d’une part il fonde une science du texte, d’autre part il libère la critique. Sa défense est hésitante, flottante entre la science et l’écriture. Picard aura le dernier mot dans Le Nouvel Observateur en montrant que Barthes se renie lui-même et qu’au lieu d’une critique scientifique, il pratique une critique tremplin ou prétexte à l’écriture. »
Quant à l’historien des idées Christophe Prochasson, il clôt son analyse de « l’affaire » par ce jugement : « La controverse s’éteint peu à peu dans le cours de l’année 1967, les événements de mai 1968 marquant peut-être tout à la fois le point final de la polémique et la « victoire » de Barthes sur Picard. »
L’histoire des idées a retenu que ces trois moments (l’essai Sur Racine, puis la réponse de R. Picard puis Critique et vérité) ont constitué l’acte de naissance de la Nouvelle critique, un champ intellectuel de la littérature, critique de l’histoire littéraire et de la toute puissance accordée à l’auteur, s’inspirant des méthodes du structuralisme et affirmant que le temps des œuvres – la littéralité définie en 1919 par Roman Jakobson comme « ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire ») – est indépendant du temps historique.
Plus d’un demi-siècle après Critique et vérité, la Nouvelle critique contenait en germe ce qui fait problème aujourd’hui : notre désir de littérature, des imaginaires qu’elle déploie dans un monde multipolaire et donc d’une critique multidimensionnelle pour en donner sens et interprétations possibles.
Signe des temps, l’écrivain et philologue William Marx a été nommé professeur au Collège de France, à la chaire de littératures comparées. Ses cours commencent le 5 février 2020.
Parmi ces ouvrages, citons La Naissance de la critique moderne (2005), L’Adieu à la littérature (Minuit, 2005), La Haine de la littérature (Minuit, 2015).
W. Marx se projette dans une bibliothèque mondiale plutôt qu’une littérature mondiale et énonce pour des « lecteurs sans limites » le « principal problème de la littérature » dans sa Leçon inaugurale, qu’il devait prononcer le 23 janvier 2020 :
« Les limites à franchir ne sont pas placées seulement dans l’objet littéraire, qu’il convient d’observer depuis l’extérieur, mais aussi dans le sujet, inconscient des œillères imposées par sa propre culture. Or, le premier obstacle à faire tomber, le principal problème de la littérature, c’est la littérature elle-même, je veux dire la notion même de littérature avec tout ce qu’elle implique de présupposés et d’usages historiquement datés et géographiquement localisés : en gros, l’Europe des deux derniers siècles. Notre amour historiquement situé de la littérature nous impose paradoxalement comme premier devoir de nous arracher à l’historicité de cette même littérature. C’est au nom de la littérature que nous devons nous détacher de celle-ci. »
Barthes, auteur de Le Plaisir du texte (Le Seuil, 1973), ne renierait pas cette vision complexe de la littérature, dans cet élan d’amour-haine que contient sa passion.
Marx le cite dans sa Leçon : « La langue est « fasciste », elle oblige à dire, affirmait ici même Roland Barthes [au Collège de France], mais la capacité de « tricher » avec elle, il la nommait littérature. La langue est fasciste, mais dix langues ensemble sont moins fascistes qu’une seule, et dix littératures forment autant de libertés nouvelles. »
C’est d’ailleurs sur les brisées de William Marx qu’allait Alexandre Prstojevic en 2016 lorsqu’il écrivait à son propos :
« Il est question d’un véritable désir de l’écriture, comme si la nature profonde de cet universitaire reconnu [W. Marx] le portait à exécuter l’ordre qu’en réponse au sévère Raymond Picard relevant, au milieu des années soixante, les erreurs d’analyse dont le Sur Racine, il faut l’avouer, n’était pas exempt, Roland Barthes intimait à la critique littéraire : devenir à son tour littérature. »