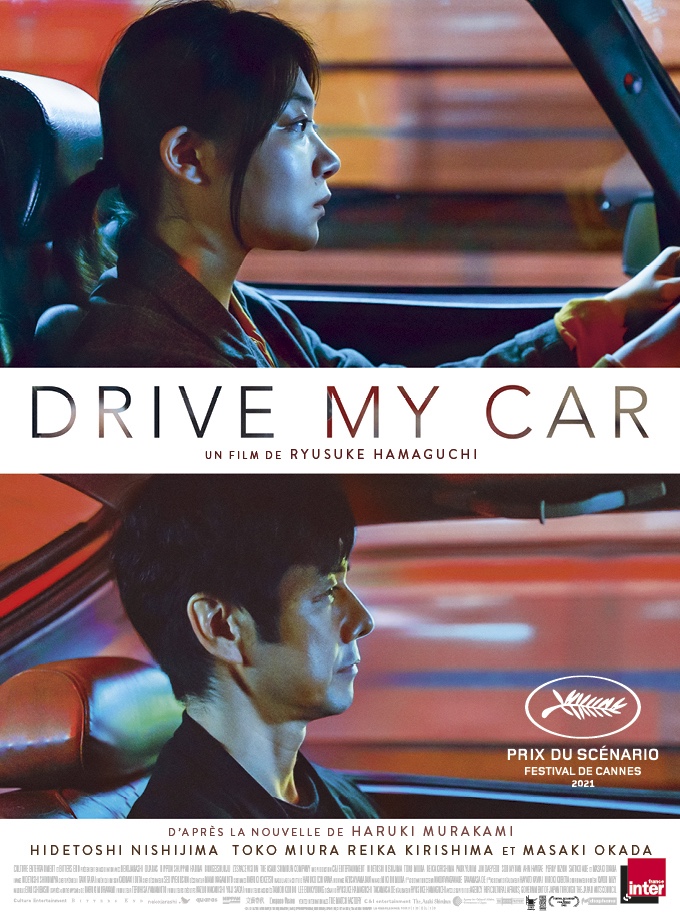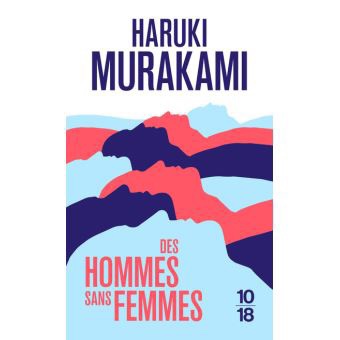Des spectateurs passionnés et passionnants, des dialogues chaleureux et approfondis entre réalisateurs ou programmateurs et spectateurs, tels apparaissent les États généraux du film documentaire, à Lussas (Ardèche). Ce qui étonne, c’est la jeunesse du public. Une jeunesse curieuse et questionnante.
À l’une des tables communes de la restauration ad hoc, on évoque le dernier film vu dans l’une des sept salles, des commentaires entendus ici ou là.
Reines-claudes
Un festivalier se reconnaît à ce qu’il porte une barquette transparente en plastique pleine de raisins ou de prunes. À ce régime, les reines-claudes du pays ardéchois sont les meilleures, sucrées et parfumées : 4€ la barquette. Effet Lussas : on se boulotte la reine-claude au kilo.
Certains échangent un euro pour un lussou, la monnaie locale pour payer sa bière ou son café au Green bar.
Salle de l’imaginaire, il reste une place au troisième rang. On s’y installe entre un technicien féru de documentaires et la journaliste du Monde, Clarisse Fabre, carnet de notes en main. On échange ses impressions avec les uns et les autres. La joie d’un festival, n’est-ce pas le bouche-à-oreille, ce qui permet de rebondir sur un film pas vu mais dont un voisin fait l’éloge ?
« Complet ! »
Mais pour que le bouche-à-oreille fonctionne, il faudrait un peu de souplesse dans l’accès aux salles, or, cette année, la billetterie occupe les esprits. C’est même un grand sujet de conversation. Chaque séance débute par un rappel des principes : « Annulez votre réservation si vous ne venez pas à la séance que vous avez réservée. » Le premier jour, salle du Moulinage, beaucoup ne sont pas venus mais n’ont pas annulé. Résultat : une quarantaine de places vides. Dans la semaine, le pli est pris mais un autre problème survient. Certains ont acheté un pass à 95€ pour la semaine mais n’ont pas réservé toutes les séances. C’est souvent complet. Ils doivent s’inscrire sur une liste d’attente en s’y prenant la veille en se déplaçant au QG ou le jour même en venant une heure avant la séance. Ils peuvent alors entrer mais si la séance affiche complet… sapristi !… ça fait cher la place de ciné.
Même les bénévoles s’y mettent, menaçant d’une « grève générale » (sic) et lisent un tract avant les séances du jeudi et vendredi matin : « Nous ne pouvons accepter la pression mise sur des équipes bénévoles ainsi que les méthodes managériales agressives, contraires à l’esprit du festival ». Très vite, un accord sera conclu.
crise de croissance ?
Serait-ce le signe d’une crise de croissance ? Peut-être faudrait-il une salle supplémentaire et trouver les 20 000 euros nécessaires pour sa location ou revenir à un système de files d’attente sans réservation, premier arrivé, premier servi… À débattre.
En repartant, sous l’abribus de l’autocar pour Montélimar, ma voisine me fait l’éloge du film d’Assia Djebar, La Nouba des femmes du mont Chenoua (1977), « un portrait captivant de la parole et du silence », commente le programme.
On le verra au retour, tant à Lussas le virus du documentaire est contagieux. D’autant qu’« Assia Djebar confère une grande place dans sa production artistique à la voix parlée et au chant, que ce soit dans ses romans ou dans ses films, expliquait Hélène Barthelmebs, en 2013. Cette volonté d’inscrire et d’implémenter la sonorité nous ramène à une communication antérieure à l’acquisition de la langue. » À lire ici.
On ira aussi glaner des films sur la plateforme du documentaire Tënk. En wolof, langue d’Afrique de l’Ouest, le mot « tënk » signifie « énoncer une pensée de façon claire et concise ».
Par exemple, ces films documentaires en forme de récits de vie partant d’une bande-son comme support à illustration. Après À vol d’oiseau, de Clara Lacombe, Last call, déroule le récit d’un fils qui raconte la cavale de son père joueur, arrêté par Interpol puis soumis à l’errance. Quelques rares photos de famille, photos de vie heureuse, sont en décalage avec les commentaires, en anglais de la mère, en français du fils. Ce rapport biaisé entre photos et commentaires souligne le malaise dans le récit, comme dans la vie, effet subtil mais dont on ne sort pas indemne, tant la brièveté du court-métrage propulse le trajet d’une vie en aphorisme tragique. Last call n’était pas programmé pendant les États généraux mais il est disponible sur la plateforme de documentaires Tënk, l’un des partenaire de ce rendez-vous annuel. Ici : Last call.