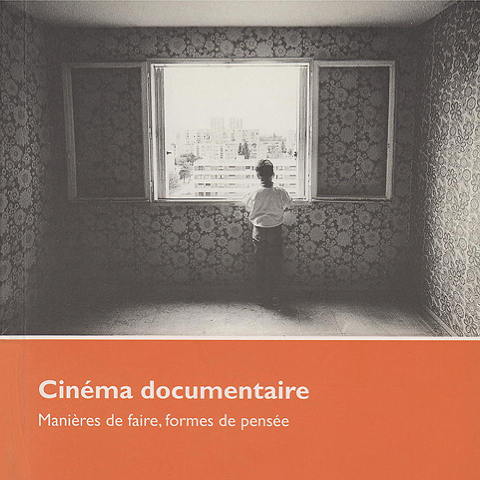Dans une salle des fêtes qui affiche complet, l’événement de mardi 19 août était assuré par le film Ceci est mon corps, de Jérôme Clément-Wilz, qui a filmé l’histoire de ses viols répétés, lorsqu’il était enfant de cœur, de sa plainte et des conséquences de son procès.
Son bourreau, le prêtre Olivier de Scitivaux, ancien recteur de la basilique de Cléry-Saint-André (Loiret), a été condamné le 25 mai 2024, à dix-sept ans de réclusion criminelle pour des viols sur quatre mineurs. (Le Monde)
Sur son compte Instagram, Jérôme Clément-Wilz avait écrit : « Ceci est mon Corps. Car pendant six ans de procédure, mon corps a été ausculté, disséqué, exhibé. Car l’exposer est un acte politique. Il dit : regardez ce que cet homme a labouré pendant ces décennies d’impunité. Regardez ce qu’il en reste. Regardez. Car pendant ces six ans, alors que tout tombait, je me suis accroché à ce que je sais faire, j’ai activé mon corps filmant. »
Corps exposé pour réparer le corps abusé. C’est l’un des films du parcours « Paroles d’émancipation » des États généraux du documentaire.
À Lussas, devant un public attentif, Jérôme Clément-Wilz affirme : « Je pensais à vous quand j’ai fait ce film. Si je n’avais pas été accompagné, je ne sais pas si j’aurais eu la force [d’aller au terme du projet]. »
Dans la tête d’une victime
Le film commence par des images d’un film de famille. Un enfant souffle les bougies de son gâteau d’anniversaire.
Puis c’est l’enquête elle-même qui est filmée par son principal intéressé. La victime est aussi le filmeur. « Légitimité de victime et légitimité de filmer » sont des paroles du documentaire.
Il est reçu par sa mère, lui étant derrière la caméra, portée à l’épaule.
Sa mère commence à lui parler d’Olivier de Scitivaux, de l’imaginer en prison, d’imaginer ce qu’il a fait.
Son témoignage alterne avec des images de lui enfant, en famille.
Clément : « J’ai des trous dans la mémoire. J’aimerais qu’Olivier me dise ce qu’il s’est passé. » [ainsi au début du film, il appelle le prêtre pédocriminel par son prénom, tant il semblait, à l’époque, familier.]
Il filme sa mère plongeant dans ses agendas. Elle retrouve celui de ses 10 ans. Elle lit à haute voix : sa date de départ en colo, la date du retour.
« J’y ai passé six ans et je ne me souviens que de deux. »
Sa mère : « On ne s’est pas rendu compte et maintenant je ne me rends pas compte des dégâts sur toi. »
Clément a peur de la confrontation avec « Olivier » devant le juge.
Il filme des entretiens avec son avocate.
Il est désemparé.
Elle lui donne des conseils psy.
Elle souligne le fait qu’il appelle la personne qui l’a agressé sexuellement par son prénom.
Il filme son entretien avec son père en visioconférence.
Son père aussi parle d’ « Olivier » en le nommant par son prénom.
Mais sa mémoire est floue quand il lui demande à quel âge il rendait visite au prêtre et le nombre de fois.
Il filme d’anciennes responsables de l’aumônerie : « Tout le monde savait. » (sic).
Il retourne sur les lieux.
La mémoire lui revient.
Le spectateur est dans la tête d’une victime. C’est l’une des réussites de ce film intime et politique. Mais il n’est pas simple de s’y retrouver entre les différents lieux.
Le Journal du Centre a écrit le 20/05/2024 : « Des agressions sexuelles auraient eu lieu dans la sacristie de l’église Saint-Paterne, à Orléans (…)
Le centre du Quinquis, propriété de l’évêché d’Orléans à Perros-Guirrec (Côtes-d’Armor), a fermé ses portes – trop vétuste – quelques années avant que les accusations portées contre le père Olivier de Scitivaux de Greische ne soient rendues publiques.
C’est là, en Bretagne, que l’ancien recteur de la basilique de Cléry-Saint-André, moniteur puis directeur des lieux, aurait agressé sexuellement plusieurs enfants. Des actes qu’il aurait également imposés sur les lieux des différents ministères qu’il a exercés dans le Loiret. Tout particulièrement dans les années 1990, époque où, rattaché à la paroisse Saint-Paterne, il avait sous sa responsabilité les aumôneries des collèges et des lycées du centre-ville d’Orléans. »
morceau de fromage
Retour au film. Séquence édifiante où Clément apprend qu’à l’époque des faits son père a écrit à l’évêque. Il hésite. Il n’en dit pas plus. Gros plan sur son morceau de fromage, qu’il coupe, met à la bouche, mâche longuement et engloutit.
Comme si la parole ne passait pas ?
Il apprend que De Scitivaux a été l’objet d’un signalement un an avant la naissance de Clément.
L’avocate : « Quand est-ce qu’on parle du « viol » ? »
Clément : « Il faut me laisser du temps. »
(Finalement, ses avocats vont demander une requalification du motif, d’agression sexuelle en viol.)
Son avocate : « Vous êtes plus en colère contre vos parents que contre De Scitivaux ? »
Dans le film, il soumet ses parents à la question. Il les renvoie à leur comportement indifférent et à leur devoir de protection défaillant.
Au public de la salle des fêtes de Lussas, Jérôme Clément-Wilz dit : « Il y a un deuxième #Metoo : comment on vit avec les personnes qui savaient. Je ne m’attendais pas à me battre contre mes parents. Mes parents, ça les arrangeait bien de ne pas mettre des mots sur la chose. »
« animiste, chrétien et queer »
Son rapport à la religion en a été bien entendu chamboulé : « J’ai été élevé catholique et me définis maintenant comme animiste, chrétien et queer. », affirmait-il à l’occasion de la sortie du clip « Nouveau Monde » (2020) tourné en Haïti.
La question du corps était déjà au cœur de sa manière et matière de filmer : « faire que les corps débordent de l’écran, que ce dernier suinte de sueur. Cela vient déjà de ma manière de filmer, en dansant avec la foule, en me laissant emporter par les flots. »
Dans ce pays, Jérôme Clément-Wilz a tourné aussi Le Fils, portrait d’un enfant adopté en Haïti par une Canadienne, et qui tentaient ensemble de « faire famille ».
La séance de Lussas s’est terminée par la projection du film québécois Elle pis son char, de Loïc Darses, où une femme décide d’écrire à l’homme qui a abusé d’elle entre ses 8 et 12 ans et d’aller porter la lettre à son ancien bourreau : « Je ne suis pas votre victime, je suis une survivante ».