En France, qui dit Japon, dit – bien souvent – Corinne Atlan, tant la traductrice du japonais s’est fait connaître par des romans célèbres, dont ceux de Haruki Murakami, de 1992 (La fin des Temps, Seuil) à 2006 (Kafka sur le rivage, Belfond) ou de ceux de son quasi-homonyme Ryû Murakami, avec notamment Les Bébés de la consigne automatique (Picquier).
Mais Corinne Atlan est aussi la médiatrice, l’intercesseuse des poètes classiques du haïku ou de figures du théâtre contemporain. Exemples ici :
et là :
Pour les détails, on consultera avec profit le site corinne-atlan.fr
Sur sa production littéraire en propre, je m’arrêterai ici sur Un automne à Kyôto qui est de saison. Il ouvre des portes dont Corinne Atlan est une des rares porteuses de clés, à savoir une culture sensible, à hauteur humaine, du Japon.
Celle qui vit « Entre deux mondes », selon le titre de son essai publié par Inventaire/Invention en 2005, a « appris à penser depuis l’ailleurs », explique-t-elle dans Un automne à Kyôto (Albin Michel, 2018).
L’ouvrage est riche en notations sensibles sur ses liens au pays et à ses habitants (des courts chapitres publiés en italique) et des réflexions personnelles, fruit de cet entre-deux, propre à sa vie de traductrice et de poète, notations qui font penser à un journal, écrit et lu au fil flottant des rencontres, découvertes de temples, évocations des langues, liens noués au gré des souvenirs.
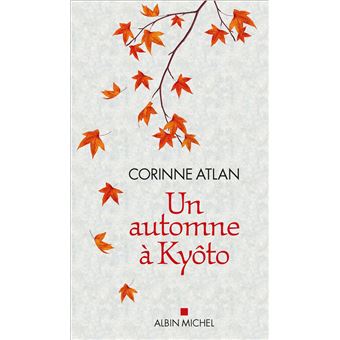
Ce « Journal de Kyôto » aime débusquer la face cachée des choses, à rebours des clichés instagrammables, ce que ses amis japonais apprécient. A Kyôto comme dans la capitale du Japon contemporain, elle note : « Le Tokyo qui exhibe ses lumières et sa puissance est une ville de « façade » (omote), mais n’oublions pas qu’au Japon, dans l’art, la mode, le langage, ou tout autre domaine, on considère « l’envers » (ura), le caché, comme plus intéressant que ce qui s’affiche. » (Japon : l’empire de l’harmonie, éditions Nevicata (2015).
Dans Un automne à Kyôto, Corinne Atlan tisse une toile d’impressions-réflexions, rencontres-évocations, sensations-histoires où elle rapproche les mondes.
« J’ai un « lien » (en) de longue date avec le Japon. Et avec Kyôto, première ville japonaise qu’il m’a été donné de visiter, à l’âge de vingt ans, sous la neige, un lointain Jour de l’an qui reste inscrit dans ma mémoire comme un moment d’intense féerie. »
Elle a expliqué quelques lignes plus haut : « Il y a un mot en japonais : 縁 (en), le « lien ». Ce lien-là est bouddhique, il résulte de la loi dite « des causes et des conséquences », qui, par exemple, réunit deux êtres en cette vie en vertu de précédentes rencontres dans des existences passées. Le en rassemble les êtres qui s’aiment, amants, amis ou membres d’une même famille, et nous relie aussi à certains lieux. »
Ses liens l’amènent jusqu’ « Au sanctuaire de Himukai, [où elle fait] halte devant l’autel du « Dieu-qui-noue-les-liens » pour lire les souhaits tracés d’une écriture sage à l’encre noire sur les plaquettes votives »
Ses impressions personnelles, « choses touchantes », comme « choses lues », ses réflexions, ses visites des nombreux temples se superposent en un camaïeu de notations et de réflexions.

[Kōyō (紅葉, littéralement « feuille rouge ») est l’appellation japonaise du changement de couleur des feuilles en automne, en particulier celles de l’érable japonais (紅葉/椛, momiji) ou du ginkgo. Kōyō est l’objet d’une coutume traditionnelle d’apprécier la beauté de ces feuilles, que l’on appelle momijigari (紅葉狩), lit. « chasse aux feuilles rouges »).
Cette coutume est à l’automne ce que hanami est au printemps : pendant quelques semaines, l’érable prend des couleurs allant du jaune au rouge vif, et les ginkgos se parent de jaune. À cette occasion, les endroits réputés (en particulier de nombreux temples de la région de Kyoto) sont envahis par la foule, notamment le deuxième dimanche de novembre lors du matsuri d’Arashiyama, créé en 1947. (source : Wikipedia)]
Autre exemple, d’Un automne à Kyôto : « Arrivez à l’heure à un rendez-vous formel : vous êtes déjà en retard (il convient de se présenter cinq minutes à l’avance). Arrivez cinq minutes à l’avance : quelqu’un sera déjà là à vous attendre. Invitez des amis à dîner à sept heures, ils viendront au plus tard à six heures quarante-cinq. Ici le « quart d’heure de politesse » s’entend : sonner à la porte quinze minutes plus tôt que prévu.
Mais, s’il s’agit d’une excursion ou d’un événement festif, on savoure le flou, on le cultive. On vous demande d’être prêt à huit heures trente, dimanche matin. À huit heures vingt-cinq, on vous appelle : finalement le départ aura lieu à neuf heures. On vous a vaguement dit où on allait, mais pas avec qui. Ou l’inverse. Remettez-vous-en à vos amis. Vous n’avez pas le choix, ils s’occupent de tout. Totalement pris en charge, vous voilà redevenu enfant : au bout d’un moment, dans la voiture, vous demandez dans combien de temps on arrive. On vous répond : « D’ici une petite heure. » Dix minutes plus tard, vous y êtes.
Vous ne saurez pas exactement à quoi vous attendre. Mais ce sera toujours un lieu magnifique, une fête rare, correspondant à un intérêt que vous aviez exprimé, un souhait que vous aviez émis sans y penser. Ici on n’aime rien tant que faire plaisir à ses amis étrangers. »
Apprécions ses notations éclairantes sur la langue, comme ce passage parmi beaucoup d’autres :
« Au marché aux puces de Kitano, je discute avec un marchand les qualités d’un objet qui concentre notre attention à tous deux. Il ne semble pas remarquer que je ne suis pas japonaise. Une fois que nous nous sommes mis d’accord sur le prix, il relève la tête et, surpris, me lance sur un ton familier : « Anta, mukô no hito ? » « Vous êtes quelqu’un de là-bas, vous ? » Je hoche la tête et nous nous sourions comme deux lointains cousins se retrouvant inopinément.
L’emploi de mukô, « là-bas », l’« autre côté », fait de nous des habitants d’un même village planétaire, alors que le terme gaijin, « personne de l’extérieur », utilisé couramment mais assez discriminant, renvoie au statut d’étranger définitivement en dehors de la société japonaise. »
Ce qui me renvoie à l’arabe, par une heureuse coïncidence, une sorte d’écho des langues sans parenté apparente.
Car ce « anta » est la forme orale du vous formel et scolaire japonais ‘anata’. Il me fait penser à l’identique « anta » arabe, qui signifie ‘toi’… Ainsi, l’espace d’un cours dialogue, sur un mot et un seul, les deux langues, japonais et arabe, se confondent en une équivoque complice.
Cette voie qu’emprunte la langue est à prolonger avec Le Pont flottant des rêves, joli titre pour un essai sur la traduction de Corinne Atlan, entre théorie (un peu) et vécu (beaucoup), édité par La Contre Allée en 2022.




